Jean-Claude Pinson, sous l’aile de Coltrane
Drôle d’oiseaux. Poètes et jazzmen sont à un battement d’ailes les uns des autres. Jean-Claude Pinson n’échappe pas à cette règle. Auditeur volontaire de John Coltrane, il le laisse parfois se poser sur sa table d’écriture. Quitte à récolter un bazar organisé, sonore et magistral. Rencontre en marge d’une création sonore.

John Coltrane © DR
Commençons très simplement. Quel est votre titre préféré de John Coltrane ?
Spiritual, dans la version live enregistrée le 5 novembre 1961 au Village Vanguard. 20 minutes 29 secondes que je ne me lasse pas d’écouter ; qui à chaque fois me transportent dans un état d’euphorie qui n’est pas très éloigné de la transe !
Il y a Coltrane bien sûr, sa façon unique de creuser (de « grever », de groover) la mélodie au sax, de balancer, danser, tendre et détendre. Mais aussi, en contrepoint, Eric Dolphy et le bourdon d’un contrebasson. Et bien sûr, pour alimenter sans faille la chaudière, la battue sans pareille d’Elvin Jones.
Dans Free Jazz vous écrivez : « C’est en écoutant J-C que j’ai compris que tout est d’abord question, non de langue, mais de lèvres ». Auriez-vous compris quelque chose d’autre encore sur vous-même en écoutant J-C ?
J’ai compris que j’étais un musicien manqué. Que si mon instrument était le langage, en réalité ce que j’y cherchais c’était l’obtention d’un son et d’un chant. Raconter une histoire ne pouvait venir que par surcroît. Et si chaque note, chaque mot devait compter, au bout du compte il ne s’agissait pas de sculpter un bibelot verbal.
Dans l’enfance, j’avais pratiqué pendant quelques courtes années la clarinette. Mais le résultat fut désastreux (un frère aîné me faisait une concurrence déloyale). J’en ai au moins gardé l’idée que le souffle doit en passer par tout un travail des lèvres. L’anche doit être humectée et pincée adéquatement. Dans Free Jazz, je joue avec cette idée en la rapportant à l’art du baiser. En matière d’écriture, ça veut dire que tout est affaire de tension et détente, de serrage (Mallarmé, mettons) et desserrage (Cendrars, mettons). Tout est affaire de prosodie : de rythme et d’accentuation.
Y a-t-il eu des périodes où votre rapport à Coltrane a pu changer ?
J’ai l’impression d’être en la matière conservateur. C’est régulièrement que j’écoute Coltrane (et souvent les mêmes albums). Il est comme une sorte de basse continue qui m’accompagne dans la vie, au même titre que quelques rares autres musiciens. Il est comme le versant afro-américain, la Great Black Music, de ce que sont par ailleurs pour moi Bach, les 24 préludes et fugues du Clavier bien tempéré tout spécialement, Scarlatti, les sonates, et Chostakovitch, les 24 préludes et fugues pour piano. Ce sont là des morceaux dont je ne me lasse jamais.
Pour le compagnonnage esthétique, c’est un peu différent. Chaque livre est écrit à la lumière de musiques qui peuvent varier selon le thème abordé. Alphabet cyrillique par exemple doit beaucoup à Chostakovitch, à son art déceptif et grinçant, à son sens aigu du grotesque et de l’ironie. Mais je crois pouvoir dire que Coltrane et le free jazz, Ornette Coleman notamment, restent en ligne de mire quel que soit le livre que j’écris, sauf les essais qui relèvent évidemment d’une autre démarche.
L’écrivain Pierre Michon a, lui aussi, nourri votre regard sur le monde. D’une autre façon que peut le faire Coltrane ?
On est évidemment dans un tout autre registre. Ce qui m’a retenu chez Michon, c’est son profond sens de l’Histoire et sa capacité à faire ressortir, en toutes ses tonalités et nuances, la teneur même d’une existence, qu’elle soit illustre ou « infâme ».
Au plan propre de l’écriture, il faut lui aussi pour moi, comme l’avait été la musique de Coltrane, un exemple libératoire. Il démontrait qu’il était possible d’allier, de concilier la nouveauté d’un langage et l’aptitude à parler au-delà d’un cercle de happy few, à toucher au plus vif qui veut bien prendre la peine de le lire (de l’écouter).
Et si l’on veut envisager son œuvre sous l’angle de la musique, on peut dire qu’il y a chez lui à la fois, dans sa phrase, la densité d’une sonate de Scarlatti (un comprimé de magie disait Giono) et la puissance fluviale, « mississipienne », faulknérienne du blues. Ce n’est évidemment pas rien.
Il n’y a pas, chez Coltrane, de militantisme frontal, comme on peut le trouver chez Archie Sheep ou Charles Mingus. Cette distance, est-elle importante dans votre rapport au monde ?
En effet, pas de militantisme frontal. C’est une posture dans laquelle je me retrouve beaucoup aujourd’hui. Après avoir été longtemps « choreute » (pendant de longues années, militant d’extrême gauche – « maoïste », j’ai beaucoup crié de slogans dans les manifs), je suis devenu anachorète. La musique des mots plus que le message me retient aujourd’hui. Je n’en demeure pas moins, comme disait Arendt, un « obligé du monde ». J’admire beaucoup un musicien comme Archie Shepp. Si la musique purement instrumentale (sans texte) le dispense de tout discours idéologique, il parvient cependant à y retrouver ce qui fait la teneur du blues et ainsi à dire musicalement ce que sont l’histoire et la condition afro-américaine – la douleur de leur tragédie, mais aussi la joie inextinguible de l’existence dès lors que musique et danse il y a. Mais parce qu’il sait aussi chanter, Archie Shepp peut être aussi plus explicitement « engagé ». C’est le mélange de tous ces registres qui fait la force de son art. Un art auquel le peuple ne manque pas, quelle que soit aujourd’hui l’audience d’un « jazzman ».
Pour en revenir à Coltrane, son engagement était avant tout d’ordre musical. Mais sa conception de la musique n’était pas étroitement artistique, c’était aussi un engagement « spirituel ». Il a eu un jour cette phrase pour justifier la longueur inhabituelle de ses solos : « je pars d’un point et je vais le plus loin possible ». S’en aller ainsi au plus loin, c’est justement le propre de l’anachorèse (on s’éloigne au « désert »). Il n’est pas étonnant qu’alors que le public ait du mal à suivre. Mais la grandeur de Coltrane, c’est qu’il est parvenu, tout en s’envolant très loin, à ne jamais perdre le contact avec la Terre – ou plutôt avec la mer, l’océan qui recouvre près des trois quarts de la planète. C’est pourquoi dans Free Jazz, pour parler de son jeu, j’ai eu recours à l’image de l’hydravion (décoller/amerrir).
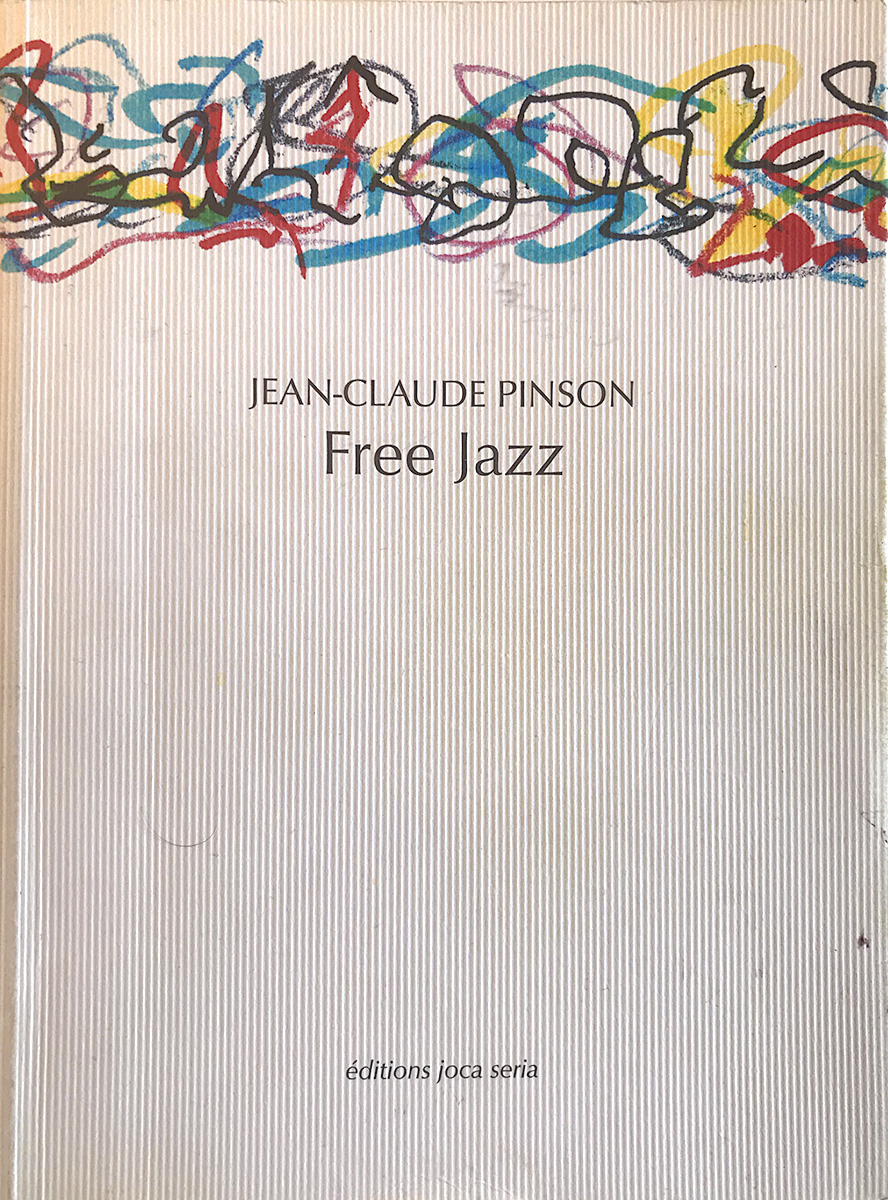
« Coltrane et Ornette vont ensemble boire à la rivière. John s’y ébroue comme un hippopotame, remue les fonds vaseux, y noie ses parasites, lance à pleins poumons un grand cri vers le ciel. Ornette est l’oiseau qui vient se percher sur son dos et se met à chanter ses airs très ironiques ».
Free Jazz, Jean-Claude Pinson
(éditions joca seria, 2004)
Il y a, dans votre écriture, une part importante pour le jeu sur votre patronyme. Est-ce que c’est une façon de se rapporter à l’enfance, à la naïveté des choses ?
Un rapport à l’enfance, certainement. Gamin, on aime beaucoup (ce n’est pas toujours très charitable et ce peut même être dangereux) jouer sur les patronymes ; on prend plaisir à activer à leur propos la « fonction poétique » du langage. Mon propre patronyme s’y prête évidement beaucoup – et non moins les initiales de mon prénom. De celles-ci, je n’ai pas manqué de jouer dans un livre où Coltrane est une figure centrale. « Les harmoniques, dit-il dans une interview, sont devenues pour moi une obsession. » J’ai recherché aussi, à ma façon, dans Free Jazz, le maximum d’harmoniques. Et ça commençait par les noms propres. La vacance en eux d’une signification obvie (du moins dans la plupart des cas) invite à ce genre de jeux de mot. Ainsi ai-je voulu voir du ferroviaire dans le nom de Coltrane (col–trane) et dans le prénom Ornette un écho hamletien (or not).
Tout cela peut s’avérer sans doute trop facile. Plus sérieusement, il s’est agi pour moi de fracturer, diviser, disséminer l’identité du sujet qui dit « je » dans le livre en question, d’en marquer l’incertitude, l’intranquillité. C’est dans une même optique que j’ai eu recours dans plusieurs de mes livres (à partir de Fado) à tout un système de personnages qui sont des quasi-hétéronymes.
Dans Free Jazz, le rythme est central. Comment le trouvez-vous ?
C’est venu peu à peu. Et rien n’est définitif, car chaque livre exige son rythme et sa prosodie propres, une forme bien à lui (je ne voudrais pas faire toujours le même livre).
J’ai très vite renoncé à la forme du recueil de poèmes plus ou moins courts, comme c’est l’usage dominant en matière de poésie aujourd’hui. Après pas mal de tâtonnements, je me suis tenu, pour la plupart de mes livres, à une forme à la fois ample (courant sur l’étendue d’un livre entier) et fragmentaire. Au plan prosodique, c’est ce qu’on appelle un prosimètre, c’est-à-dire une alternance de poèmes brefs en vers courts et de passages plus longs en prose ou versets. Des sprints soudains rompant le rythme plus lent de courses de fond. Trot troué de galops. Pas de règle précise ; tout cela est très intuitif. Un possible modèle syntaxique et rythmique (du moins l’ai-je très souvent en tête : celui d’un match de rugby . Longues séquences où l’emporte la prose du jeu d’avants progressant pied à pied et puis soudain la fulgurance d’une attaque (inspirée si possible) de trois-quarts.
Comment naît la forme d’un livre comme Free Jazz ? Serait-ce le vent des fulgurances qui en fait ce qu’il veut ?
Fado (avec flocons et fantômes), paru en 2000, était construit sur le modèle d’un opéra de chambre. Free Jazz, qui vient après, ne se veut pas seulement une évocation thématique du free. Ni même simplement une tentative de transposition, dans l’ordre de l’écrit, de l’allure propre à ce type de musique. C’est très précisément le double album d’Ornette Coleman portant ce titre qui m’a guidé. J’ai cherché un équivalent textuel à sa structure contrapuntique (celle du double quartet) en inventant un dispositif où Ornette Coleman et Coltrane sont en constant dialogue (on sait que le second avait pris quelques leçons auprès du premier pour improviser sans s’appuyer sur les grilles harmoniques).
Le tableau de Pollock (White Light) ornant la pochette du 33 tours m’a aussi servi de point d’appui. J’ai cherché à transposer dans l’écriture la profusion des taches et coulures qui font la singularité de sa texture, son côté poïkilos (bariolé).
Pour le reste, tout est affaire de circonstances – de ce que vous nommez de cette belle formule, « le vent des fulgurances ». On peut appeler ça aussi, si l’on n’a pas peur d’un vieux mot, l’inspiration. Il s’agit alors de faire entrer dans le livre tout ce qui advient à la fois à l’existant que je suis et au livre en chantier. Concourent à cette météo infiniment changeante des circonstances aussi bien les particularités d’un lieu, d’une saison, d’un moment de la journée, d’un événement biographique (la vie de Coltrane) ou autobiographique, que telle ou telle idée adventice, survenue à l’improviste. Ou encore telle ou telle soudaine focalisation sur un vocable, telle prise en considération de la réalité visuelle de la page elle-même où l’hydravion d’une phrase tente d’amerrir…
Spiritual
Quelle est la place de l’oralité dans vos travaux ? Est-ce que vous “écrivez à voix haute”, selon la vieille méthode de Flaubert ?
Je ne suis pas un poète « performeur ». L’oralité en ce qui me concerne ne monte pas sur la scène. Si elle parle, c’est « à blanc », silencieusement, un peu comme Coltrane s’exerçait chez lui sans recourir au son, travaillant seulement ses doigtés, pour ne pas déranger ses voisins.
Néanmoins, il s’agit bien de faire passer dans l’écrit quelque chose de la verve propre à l’oralité. Si je ne pratique pas le « gueuloir » flaubertien à jet continu, il m’arrive cependant assez souvent de passer telle ou telle phrase ou séquence au banc d’essai de la profération à voix haute.
Est-ce que dans votre écriture, comme pour le jazz, il reste de la place pour l’hésitation et pour l’improvisation ?
Dans l’improvisation, il y a une contrainte qui est un risque : le remords, le repeint, la retouche ne sont pas possibles. Impossible de revenir en arrière. La littérature étant au contraire foncièrement rature, comme disait Barthes, on ajuste et on rectifie sans fin ; on multiplie les brouillons.
Au plan de l’écriture, on peut toutefois pratiquer ce qu’André Hodeir appelait « l’improvisation simulée ». Se mettre à l’école du free-jazz, de son refus de toutes les structures et grilles préétablies, ce n’est donc possible qu’en mode second, altéré, transposé. Cela passe d’abord par un geste négatif, consistant notamment à déconstruire la linéarité d’une narration continue autant que la stabilité d’une forme poétique identifiable. En contrepartie, « positivement », il s’agit d’être constamment en alerte, attentif à la moindre déviation possible surgissant au détour d’une phrase. C’est en somme un art du clinamen (de la bifurcation aléatoire, du dérapage fécond), art verbal qu’ont pratiqué à leur façon les avant-gardes russes du début du XXème siècle sous le nom de sdvig.
—
propos recueillis par Arthur Guillaumot, mai 2021
—
D’autres interviews pourraient
également vous intéresser,
c’est par ici.
