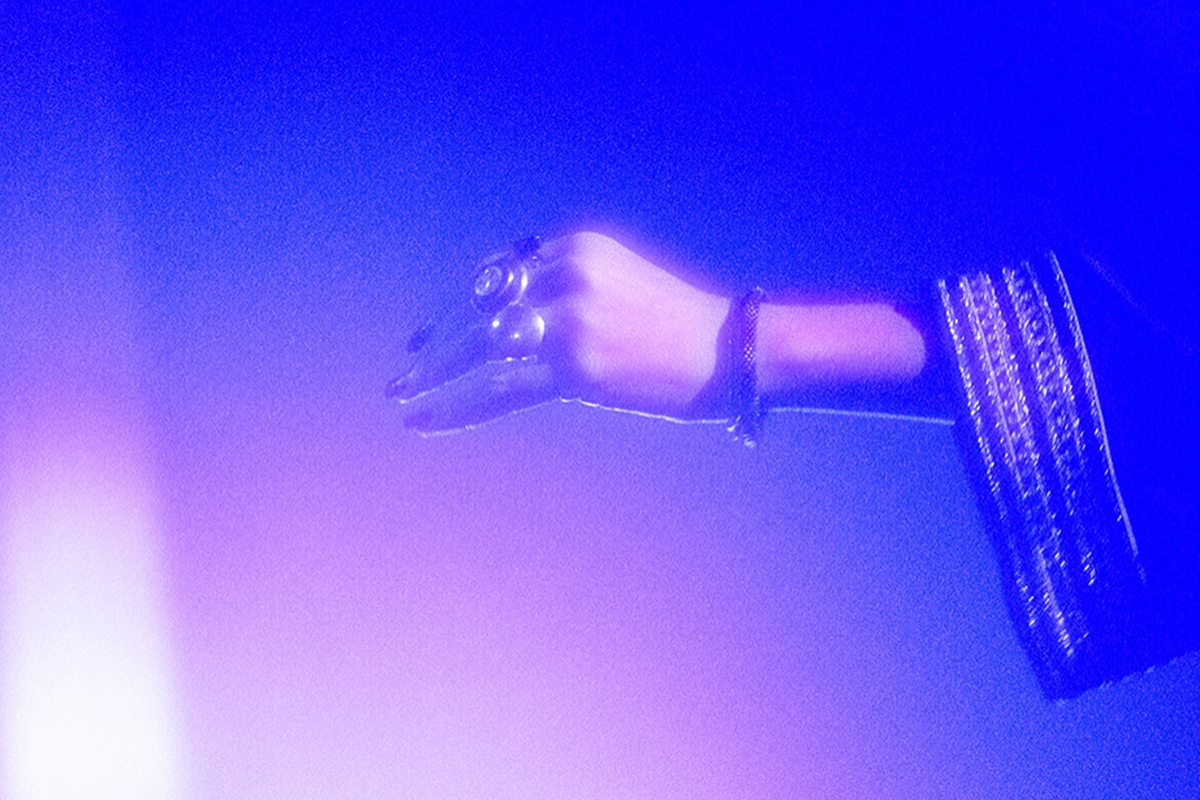« Trompette tarée et boucles électro, à faire battre le palpitant et les âmes jusqu’aux tréfonds des cages thoraciques. Minimalisme du trait d’au-dessus, basse souterraine qui fait trembler les fondations du sous-sol. »
tribu festival 2025
— chroniques
jeudi 25 septembre
Grégory Dargent – Soleil d’hiver
Un Singe en Hiver
Soleil d’hiver, c’est un récit de famille. L’histoire d’un retour impossible, d’un western imaginaire où l’Ouest américain serait de l’autre côté de la Méditerranée, au Sud de l’Algérie et du Liban. Seul en scène, Grégory Dargent, en argonaute noise. Oud, console et pédales numériques comme bêtes de somme, films et photos projetés en arrière-scène pour paysages. Départ de la caravane du Tribu 2025 pour une B.O. de road trip multisensoriel : les souvenirs d’abord, des photos en noir et blanc projetées, des gosses qui courent, des chiens qui posent. L’enfance et la nostalgie sont là. Avant que cet album de famille ne se mette à brûler, devant les images des immeubles vétustes et les rues ravagées. Grégory Dargent construit l’empreinte sonore de cette quête des origines qui n’a jamais eu lieu ailleurs qu’à cet instant, face à nous. C’est une peinture sonore, une de ces fêtes populaires, celles où le riff et la transe vont de pair, unis en une frénésie sonore. C’est un désert plein d’échos venus du Oud devenu bruitiste et électrique, un feu de camp qui brûle les souvenirs acoustiques pour les transformer en délire électronique. Avant ce trait de fin, face à la mer et à sa quiétude. (llt)
[NA] invite Étenèsh Wassié
Consortium Museum
[Na], trio punko-jazzistique, entre en réaction chimique avec le répertoire traditionnel et intense de la chanteuse éthiopienne Eténèsh Wassié. Cette rencontre nous laisse penser que la catastrophe apprivoisée chère à Jean Cocteau se distille toujours. De l’alambic d’hier soir ressort quelque chose de plus roots, plus blues, plus libertaire que le set de [Na] au Tribu 2023. Aujourd’hui, le trio a le son lourd, la batterie puissante, la guitare baryton qui sonne comme une basse Rickenbacker façon Motorhead. Ce 3 +1 récupère les tubes à essais mis de côté pour en créer une pierre philosophale instable et joyeuse. Étenèsh Wassié et Rémi Psaume dialoguent sur un groove chaotique, voix puissante et infinie contre le sax growlant, imbibant les riffs rythmiques du groupe de nouvelles mélodies qui semblent avoir été là depuis toujours. Comme dans un échange entre correspondants, on se partage les morceaux. Eténèsh Wassié tranche de son verbe le On attend l’utopie, tandis que les [Na] dépresseurisent leur post-punk dans les traditionnels éthiopiens. Ces progénitures ont été initialement biberonnées à la réunion Getatchew Mekurya & The Ex, entendue par ailleurs au Tribu 2008. Une courte vingtaine d’années plus tard, il flotte comme un parfum d’une boucle parfaitement bouclée. (llt)
Christine Salem – Renyon
Consortium Museum
Christine Salem est aussi décoiffante que sa musique. Autour d’elle, basse, batterie-percussions et guitare s’unissent aux voix des chœurs pour créer une atmosphère sonore unique, un mélange qui donne une version possible du Maloya contemporain. La musique née dans l’esclavage redevient, pour ce concert, un cri de liberté. Porté par cette voix, il met en mouvement des messages d’amour et de revendications. Une éruption de détermination et de lumière s’abat sur la foule. La forçant à s’unir pour siffler ou taper du pied en rythme. Au cœur de Dijon, elle nous « ramène la chaleur de La Réunion ». Cette chaleur musicale se reflète dans les bijoux dorés pendus au cou, aux poignets ou encore aux oreilles de la chanteuse. Soulève un mouvement aussi imprévisible que bouillonnant, tresse dans la salle un défoulement. Une unité se crée au gré de sa voix puissante et captivante. Ce cercle incandescent où la lumière rouge et les sonorités endiablées prennent leur place. Ces chants de ralliements que Salem scande et impose à la salle deviennent cri commun. Parfois rugueux, parfois veloutés, ils ouvrent un espace brûlant où mémoire et présent dansent avec l’assemblée. (obd)




vendredi 26 septembre
Rebecca Roger Cruz
Consortium Museum
Rebecca Roger Cruz a du coffre. Du genre qui impose son propre tempo aux ensembles, aux gens, aux astres. Ici, au Consortium, elle installe un mini-temple : scénographie calquée sur celle d’une cérémonie religieuse, chœurs et cordes derrière la prêtresse en robe de feu. Après le Soleil d’hiver qui éclairait Grégory Dargent, la veille, la lumière du jour est celle du crépuscule qui nous brûle par les prêches de cette voix. Les cantiques de la native de Caracas nous baladent des mers, peintes par le trio violon-violoncelle-contrebasse jusqu’aux tristesses des âmes délogées par un face-à-face batterie-percussions. Exil, diaspora et ce qu’il reste de synonymes dans toute notre palette d’émotions face à cette musique vibrante. Le Consortium abrite une caravane de pèlerins, tremblant autour d’un feu païen où les dodelinements du public face à un orchestre de fidèles et aux traits vocaux intenses pourraient faire vaciller, à tout moment, cette embarcation précaire. Musicien·nes et auditeurices dans le même camp, suivant aveuglément la prophète habitée qui chante, crie, frappe et virevolte. Et le public de suivre à son tour, sa messie du jour. (llt)
Aïta mon amour
Consortium Museum
Direction le Maroc et ses plaines. Ce soir-là, Widad Mjama invoque l’esprit des femmes-chanteuses chikhates, conteuses féministes rebelles à l’œuvre à l’ouest du Maghreb, façon field hollers du blues des campagnes américaines. Aux côtés de cette pionnière marocaine, Khalil Epi s’attèle à ses machines, claviers et cordes pour glisser ces hymnes des campagnes dans un écrin synthétique de riffs électroniques. En quelques secondes, musique urbaine populaire et folk marocain unissent la fosse du Consortium. Synchronisation des pas, réponses d’une bouche aux autres bouches. Vingt minutes passent, la salle devient bazar-dancing, les bouibouis et bibelots sont remplacés par deux-cents choristes transpirants. On y resterait des heures sans boire, sans manger, juste pour vivre de ces percussions grondantes, de ces boucles électro-hypnotiques et des ritournelles cinglantes de Mjama. Cette Aïta trace sa propre histoire, indomptable, balançant entre les riffs traditionnels et les grooves à espace façon Portishead. Seul répit, le drop des machines. Quelques secondes de suspens avant que les corps ne s’y glissent à nouveau, délicieusement. (llt)
Sami Galbi
Consortium Museum
Le petit prince du Raï balance direct. Autotune qui cisaille, percus qui cognent sec, synthés qui alternent le clinquant et l’abrasif. Pas de montée en douceur, pour ce retour gagnant après le très bon solo de 2024 à La Vapeur. En 2025 et en trio, le son s’impose de lui-même dans la chaleur de l’électro qui enveloppe Sami Galbi. À ses côtés, Inès Mouzoune aux machines et synthés et Yann Hunziker aux percussions. Le Raï selon Galbi s’en trouve retourné comme une matière première chââbi , mélangée à la trap marocaine, à des machines faites pour le bricolage savant. C’est génialement bancal. Pas vraiment une fusion mais le genre de rapport de force permanent où chaque élément garde sa rugosité. Politiquement, ça tape juste, comme des gros coups de subs bien pointus le feraient. La mémoire populaire est lancée, malaxée, retravaillée en direct, à même le dancefloor. De leur héritage, Galbi et ses comparses fabriquent du présent sans vendre de nostalgie. Et ce présent, il est bruyant, instable, traversé de tensions. Musicologiquement, c’est un jeu d’équilibre en action : voix traitée comme un instrument blessé, percussions qui refusent l’accompagnement docile sans pour autant troubler le groove, synthés qui ne concèdent jamais rien au décoratif. Ça danse, oui, mais sur une ligne de crête. Une lame de rasoir qui pousse ce concert, au final, à offrir cette sorte de secousse dont on se souvient longtemps. On sort avec le corps en mouvement et la tête pleine de questions, ce qui, avouons-le, est un combo du genre plutôt rare. (snd)




samedi 27 septembre
Orchestre National de Jazz
Opéra de Dijon
Quasi deux heures d’un set qui tiendrait du film choral, joué à l’auditorium, cinémax blindax. Dix-sept musicien·nes, à la maîtrise parfaite, à l’auto-dérision idem : chacun·e a son solo, sa scène, sa folie distillée en grain. La virtuosité est là — millimétrée, redoutable — mais toujours traversée par ce sourire en coin qui distingue l’exercice de style de la jubilation partagée. Au centre de cet écran sonore imaginé par Sylvaine Hélary, toute nouvelle tête de l’ONJ, la batterie et le vibraphone comme axe de symétrie, colonne vertébrale de l’orchestre. Autour, les masses se déplacent. Travellings : cordes qui surgissent en contrechamp, cuivres en gros plan, souffleurs en plans-séquences saccadés. C’est du cinéma sans caméra, une mise en scène spatialisée par le son.
L’ombre lumineuse de Carla Bley plane sur cela. Compositrice, pianiste, cheffe d’orchestre, l’iconoclaste Lady a traversé plus d’un demi-siècle de jazz en refusant les hiérarchies : femme dans un milieu d’hommes, satiriste dans un univers qui se prend au sérieux, ironique là où d’autres aiment ériger des monuments. Dans son écriture, lyrique et caustique, dialoguent les mélodie les plus simples et de régulières déflagrations orchestrales improbables. C’est ce legs qui est repris ici, démonté, réarrangé. La paire Sylvaine Hélary/Rémi Scuito, co-arrangeur de With Carla, ne rejoue pas Bley. Ensemble, ils en prolongent l’esprit frondeur : humour dans les décalages harmoniques, polyphonie comme espace de dissension, ironie comme moteur de liberté. Chaque pupitre garde sa voix propre, d’où jaillit une joie féroce. Enfin, il y a ce cadre : du jazz joué à l’opéra, toujours amusant ce petit frisson de casser quelques cloisons rétives, de déborder des répertoires.
L’orchestre sonne en plein. Il est de son temps, peut-être même en avance. Multi-genres, intergénérationnel, inclusif par nature. Aucun doute sur le fait que la meilleure façon d’honorer Carla Bley est de continuer à inventer, ensemble, dans un désordre joyeux. (snd)
HHY & The Kampala Unit
Consortium Museum
La Tribu Team donne son triple A, garantie sans risques sur les marchés financiers. Celui du AAA.Afrofuturisme. C’est samedi soir, il est 21 heures, et flotte cette impression que la soirée de la veille a continué. Ici, pas de chichi. Le duo Portugo-ougandais réuni lors du dernier festival Nyege Nyege se la donne. Trompette tarée et boucles électro, à faire battre le palpitant et les âmes jusqu’aux tréfonds des cages thoraciques. Minimalisme du trait d’au-dessus, basse souterraine qui fait trembler les fondations du sous-sol. Beat sec juste derrière, avec ces lignes de trompette trempées dans l’acide, jouant plus sur son absence que sur sa présence. On joue de cette battle inégale, dansant dans la finesse, contre les séismes électroniques. On bouge sur l’ostinato de la phrase contre un mur sonore de boucles. L’Afrique sonore d’aujourd’hui est ainsi faite. Elle prolonge l’Afro-futurisme génial édicté par Octavia Butler, elle rassemble les rythmes du monde, jazz brisé, funk dépecé, électro défoncée, rythmes usés jusqu’à la corde, et les repousse jusqu’aux limites planétaires. One nation under a groove, ce mantra tonne et sonne une fois encore, pour mieux nous préparer aux temps troublés qui s’annoncent. (llt)
Sisso & Maiko
Consortium Museum
Petits chapeaux, T-shirt bleus frappés du logo Tribu, deux silhouettes débarquent. Petits Schtroumpfs DJ turbulents. Aux platines et aux machines, Sisso & Maiko lancent la mécanique singeli : tempo fou, basses qui giflent et rythmes serrés comme des ruelles de Dar es Salaam. La fosse est happée, aspirée dans un set dont la vitesse refuse définitivement de lever le pied. Soudain, les beats se frottent à la mélodie qui déboule sans prévenir : flûtes, sifflets, instruments à vent traditionnels s’invitent dans le flux électro-puncheur. Entre deux accélérations, les deux musiciens frappent le sol de leurs sandales, et inventent illico une batterie bricolée sous leurs pas. Tout devient percussion, tout devient pulsation. Sans réfléchir, sans ralentir. Les corps s’échauffent, les couches sonores s’empilent. Tarab, techno, afro-house, hip hop. Pas de place au seul plaisir, encore moins au hasard. Dans ce chaos ultra précis, se glisse une ironie politique : la marge dicte son tempo, la contrainte des appareils d’Etat se retourne en fête collective. À Dijon, c’est Zanzibar au coin du bar, c’est l’appel de la classe ouvrière très classe, c’est un set comme un cyclone : une musique trop rapide pour les cases, trop vivante pour les musées, et furieusement assez libre pour transformer un dancefloor en carnaval féroce et indomptable. Une cavalcade parfaite. (llt)
—
textes de Selma Namata Doyen, Octavine Brobbel-Dorsman et Lucas Le Texier
photos © Alice Forgeot, Tribu festival
—
tribu : infos +