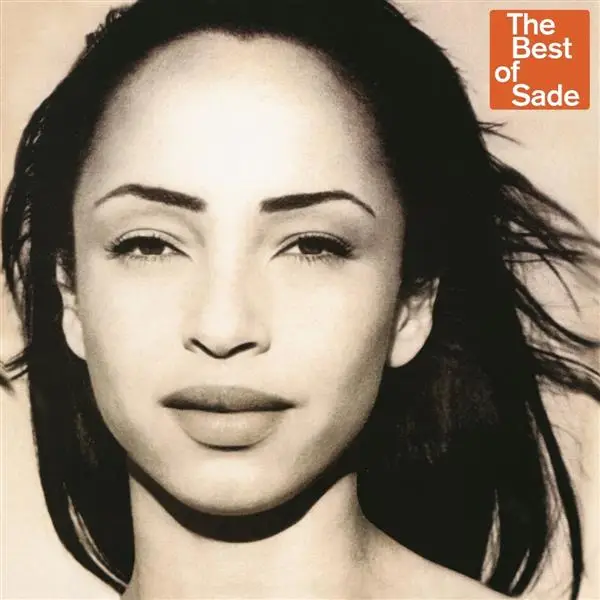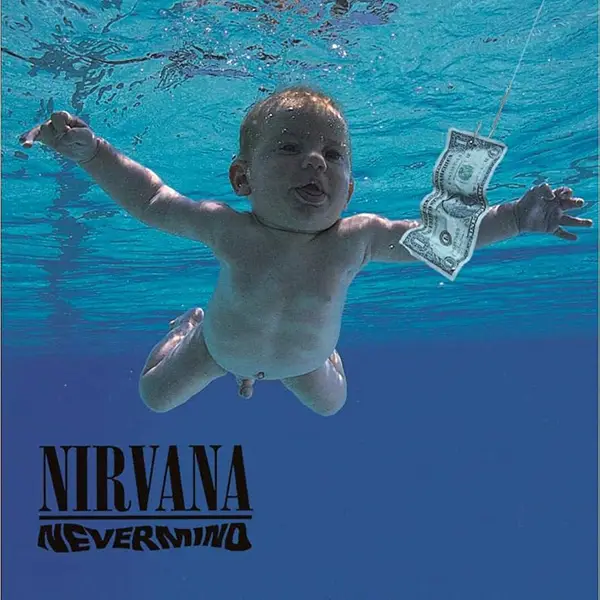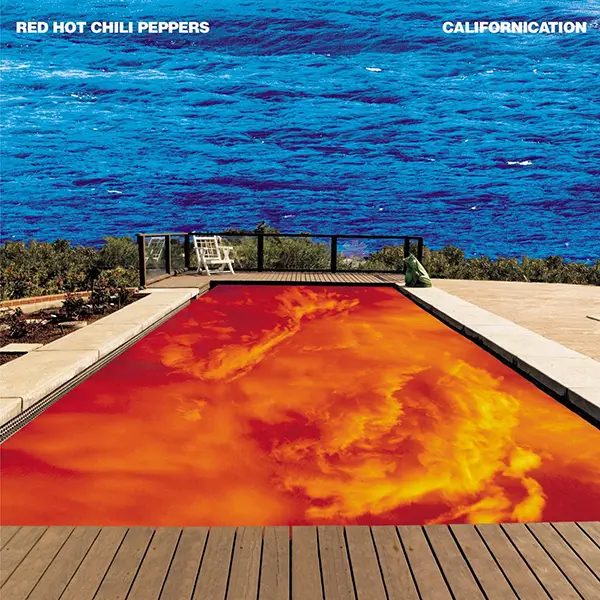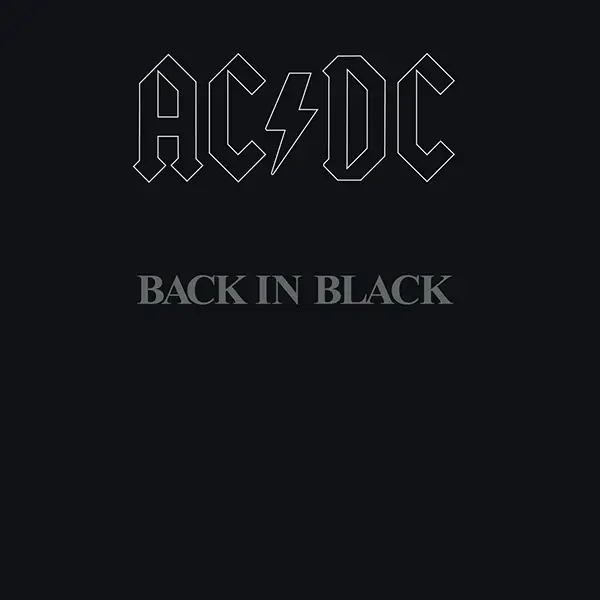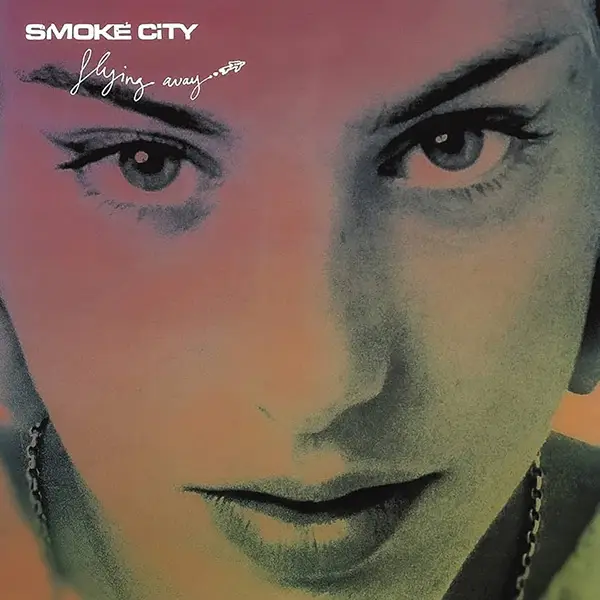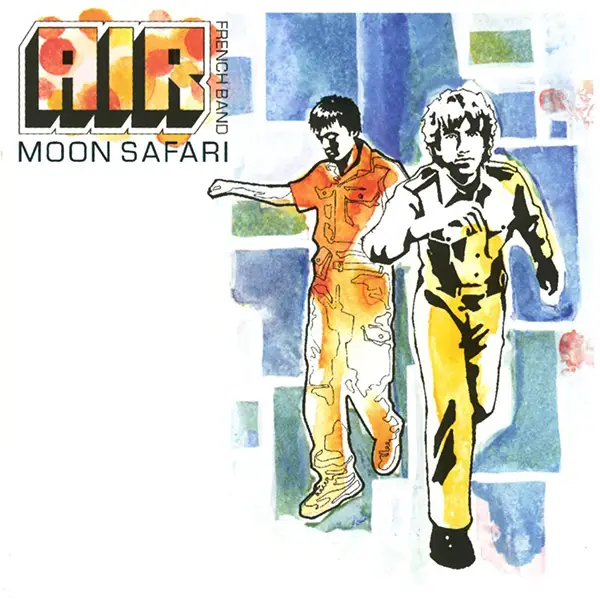« Je portais fièrement mon t-shirt Kurt Cobain en me croyant un peu au-dessus des autres avec mon album de rock alternatif dans les oreilles. »




la chambre jeune
— chroniques
Comment des disques de darons arrivent-ils jusqu’aux tympans de la GenZ ? Comment impriment-ils ? Pourquoi durent-ils ? Le bon goût est-il soluble dans la génétique et les statistiques ? Chaque semaine, pour la newsletter de pointbreak un jeune de la rédaction range sa chambre.
Assise à une terrasse sous la douceur du soleil de décembre, j’écoute. Les gens passent commande, les serveurs se pressent et mon amie, au milieu de tout ça, me partage une artiste qu’elle apprécie. Je découvre Sade et son morceau Kiss of Life. La compilation de ses titres les plus connus sortie en 1994 deviendra par la suite l’un de mes tout premiers vinyles.
Aujourd’hui, Best of Sade accompagne la plupart de mes soirées. C’est toujours quand la nuit s’installe que je cherche une ambiance sonore semblable à la musique douce et sensuelle de la chanteuse nigériane. Voix emblématique de la musique soul et jazz, Sade a marqué mon esprit par sa capacité à traverser les générations. Pour preuve, mon vinyle s’est aujourd’hui déplacé dans la platine de mes parents avec qui je partage souvent cette atmosphère posée à travers l’écoute de l’album qui m’a fait tomber amoureuse des sonorités jazz et quiet storm, des musiques qui ne vieillissent pas.
Quand j’étais petit, lors des longs trajets en voiture, mon père passait ses CDs. Des Stones à Eminem, en passant par Daft Punk ou même Youssou N’Dour, il n’y avait souvent aucun rapport entre les titres ou les genres qui s’enchaînaient. J’adorais ça. J’adorais essayer de deviner quelle musique allait passer. J’espérais secrètement que mon père insère « le disque avec l’obèse ». C’était You’ve Come a Long Way, Baby de Fatboy Slim. Sorti en 1998, mon père avait découvert ce disque dans une compile électro des Inrocks. Je ne comprenais pas vraiment ce que j’écoutais, j’aimais cette musique, c’était entraînant, ça me faisait bouger, et je me souviens que c’était le cas de tout le monde dans la voiture.
« Well, huh, my favorite artist right now is Fatboy Slim, that guys kick ass. »
Aujourd’hui, 10 ans plus tard, j’écoute l’album régulièrement et je le place très haut. L’alchimie des morceaux big-beat : construits avec un tas de samples, allant des dialogues de films au disco des années 70, de la funk au rock des années 80/90 en passant par de la musique indienne des années 60. Le plaisir d’écouter ces titres entraînants, ingénieux, drôles, qui évoquent, aujourd’hui, pour moi, une certaine nostalgie. C’est ce disque qui m’a donné envie d’écouter d’autres artistes electro, devenu par la suite, un de mes genres musicaux favoris.
Remontons dans mes années collège, lorsque je cherchais un style un peu plus cool au lieu d’être juste moi-même. Le collège en gros. À ce moment-là, la tendance s’est en partie tournée vers les années 1980-90, le grunge, et ce côté un peu alternatif de la mode. C’est là que j’ai redécouvert Nirvana. Je connaissais déjà, mais avant ça, je ne m’y intéressais pas. Puis vient l’album Nevermind. Le plus connu évidemment, mais surtout celui qui m’a construit une identité pendant un moment.
Je portais fièrement mon t-shirt Kurt Cobain en me croyant un peu au-dessus des autres avec mon album de rock alternatif dans les oreilles. En boucle les titres Come As You Are et Smells Like Teens Spirit, les plus connus encore une fois, mais ça me suffisait. Puis j’ai écouté le reste de l’album avant de passer à autre chose car même s’il me plaisait, c’était surtout une question de mode. Ça m’arrive de le réécouter, je n’ai jamais fait semblant de l’apprécier. Mais maintenant, cet album me ramène surtout dans la nostalgie de mon année de 3e.
Au lycée, quand j’ai commencé à troquer le rap pour le rock et l’électro, j’aimais bien écouter les albums les plus connus des groupes mythiques pour mettre la tête dans l’eau. C’est comme ça qu’un soir, sur le trajet pour rentrer, j’ai décidé d’écouter l’album Californication des Red Hot Chili Peppers, sorti en 1999. J’ai pris une claque tant le son des piments rouges m’a impressionné. Le rythme entraînant des titres, porté par la voix nasillarde d’Anthony Kiedis, les riffs de John Frusciante et bien sûr, les lignes de basse de la Puce, m’ont transporté sous le soleil brûlant des côtes angelinos, le terreau de la clique. Avec plus de recul, je me suis rendu compte que, côté thèmes, c’est tout aussi puissant, la superficialité californienne est dénoncée, l’amour est chantée, et plein d’autres choses sont racontées. Ai-je été californicationisé ?
Un quatuor anglo-saxon et une ouverture au rock sans retour depuis. Séduit, marqué, tatoué par sa musique, ses membres, son univers et cet album, Blur. Moins britpop que les précédents plus brut, plus sérieux, plus crade. Moins Blur (malgré son titre éponyme). Une vieillerie jamais rouillée. Avec ce disque sorti en 1997, les london boys prennent un virage vers le rock alternatif, un peu ennuyés d’être vus comme un « groupe anglais rigolo et arty ». Graham Coxon, le guitariste, est admirateur de Sonic Youth. À l’écoute, on sent tout de suite la nouvelle affaire : riffs sont lents et saturés, voix qui grésillent, on pourrait presque ne rien reconnaître. Le ton est aussi plus intime que dans les disques précédents. On aborde l’héroïnomanie du frontman Damon Albarn (Beetlebum), l’alcoomanie de Coxon (You’re so Great) et on ironise sur le mouvement grunge d’outre-atlantique (Song 2). Bref, Blur, c’est une grande prise de risques, Blur, c’est un album créatif et expérimental, Blur, c’est le plâtre qui a fait renaître un mastodonte en berne après s’être fait casser une jambe par les frangins Gallagher.
Récemment mon père a eu 60 ans. Ça arrive. À 15 ans, il découvre l’album Back In Black de AC/DC. Depuis quelques années plus tard, il me transmet les titres qui ont bercé une grande partie de sa vie. Ce disque résonne encore aujourd’hui, et, comme un écho des années 1980, a fini par me convaincre à mon tour. Je ne sais pas si c’est la nostalgie des moments passés à l’écouter pendant l’innocence de l’enfance, ou juste la transmission du son du rock à travers les âges, mais il m’arrive parfois de réécouter Hells Bells ou Back In Black. Pourtant très loin de mon style habituel. Ces titres restent pour moi du genre classique intergénérationnel. Intergénérationnels car sans mon père, je ne ressortirai surement pas encore ce disque de temps en temps. Classique car, beaucoup, parmi ma génération, doivent avoir probablement des histoires similaires tant ce groupe a marqué l’histoire depuis ce 25 juillet 1980, jour de sortie d’une masterclasse australienne vieille de 45 ans.
Dans ma famille, tout le monde aime Daft Punk. Mon père est fan, je veux dire vraiment fan. Il a toujours balancé leur musique à tout-va. À table, en voiture, dans le salon, dans nos chambres, c’est devenu la bande-son de beaucoup de mes souvenirs. Sans aucun doute, les allèles qu’on partage. En grandissant, naturellement, j’ai eu entre les oreilles toute la discographie de Guy-Man et Thomas. Par exemple, Discovery, 2001. Les french-touchards sont au sommet. C’est le deuxième disque du duo, un concentré de savoir-faire. Le duo casqué touche la pointe de la pyramide. Une ascension permise par une tonne de samples alliant funk, disco et pop plus rock avec de gros riffs électriques. Le résultat ? Des titres venus d’un autre système solaire : dance super joyeuse et nerveuse, downtempo tout doux et romantique, disco survolté. Des génies et leurs machines, à tester une fois dans sa vie. Le projet versaillais hyper versatile se fait aussi un film. Littéralement. Ses tracks forment la B.O d’Interstella 5555, animé qui se vit comme la version mouvante d’un disque devenu classique.
À peine deux semaines de fac quand je tombe sur Flying Away. Je suis encore dans cette phase un peu molle où tout est nouveau, où tu essaies d’avoir l’air cool dans les couloirs sans savoir encore qui tu es. Et là, au détour d’un vieux post Reddit, je lance Underwater Love de Smoke City. Bizarrement, j’ai tout de suite eu l’impression d’avoir déjà entendu ce morceau quelque part. Peut-être parce qu’il a ce truc moite et hypnotique, entre la bossa-nova, le trip-hop et le jazz, un son de plage un peu perché, entre trip et chill. Flying Away, sorti en 1997, c’est le seul vrai album de Smoke City, et pourtant il sonne comme une compilation de mondes parallèles. Il y a du Portishead sous acide exotique, du Massive Attack parti en Erasmus sous les tropiques. Mais, surtout, la voix de Nina Miranda : planante, suave, un peu éthérée, pile dans le délire déjanté de Michel Gondry. Je me souviens avoir laissé tourner l’album un soir, allongée sur mon lit : « Voilà, c’est cette ambiance qui me fait planer ». Ce mélange de sons qu’on devrait pas oser assembler, mais qui s’emboîtent parfaitement. Comme si la nonchalance pouvait être une forme d’élégance. En vrai, Flying Away m’a appris un truc sur la musique. Parfois, les albums les plus marquants, vont être ceux qu’on ressent. Ceux qui font flotter le cerveau sans qu’on sache trop pourquoi. C’est sans doute pour ça qu’il vieillit bien. Sans chercher à coller à une époque, il flotte, littéralement. Il s’en fout des tendances, il plane au-dessus. Aujourd’hui, encore, ce disque me surprend toujours. Ce disque, c’est pas un souvenir, c’est un état d’esprit.
Les années Collège et mon frère partage régulièrement avec moi ce qu’il écoutait. Grâce à lui, au lycée, je me lance dans l’aventure des jungles musicales. Deux ou trois ans avant cette chronique, il m’avait fait écouter Sexy Boy de Air. J’ai tout de suite accroché. Hypnotisant, entraînant, mais planant en même temps. Je n’avais encore jamais rien entendu de tel. La voix androgyne et distordue de JB Dunckel. Les vocalises robotiques bizarres. Peu de temps après, alors que je lui en faisais les éloges, un ami me convainc d’écouter Moon Safari, habitat naturel du titre, album majeur du duo et big-bang de leur carrière. Embarquement dans le vaisseau de l’architecte Nicolas Godin et du physicien Jean-Benoît Dunckel. Dix sur dix, transcendance vers les astres, voyage dans la lune. Secousses et mélodies éclectiques, produites par des engins des années 70 : Fender Rhodes synthé Moog, orgue Korg, delay à pédale. Naissent alors des paroles à interpréter et réinterpréter sans cesse, et des titres solaires et crépusculaires, joyeux, rassurants, comme La femme d’argent, mélancoliques et introspectifs, comme Talisman. Brillants sous tous les points. Sensibles, savants, composés avec justesse. Moon Safari, grand pas pour la French Touch, et petit pas très classe dans ma playlist infinie.